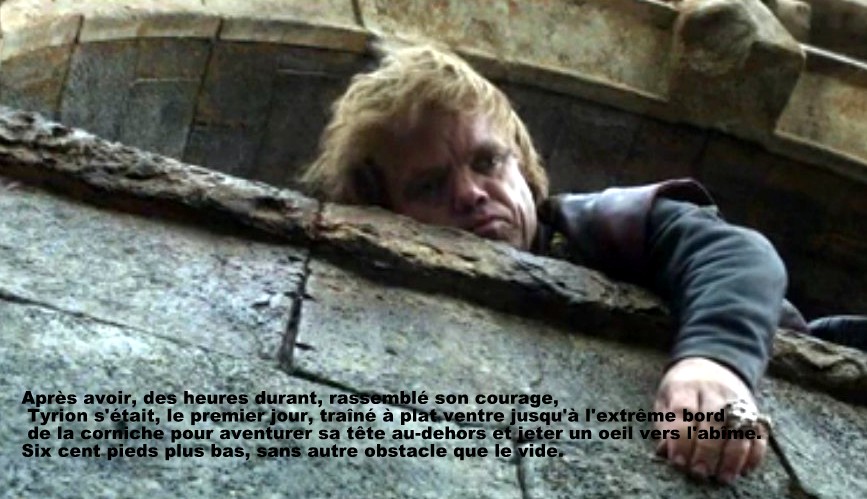|
| réedité en 2011 |
Qu'est-ce que la vie quotidienne ?
Cela semble vaste, très vaste...Ce que je mange au petit déjeuner, comment je me rends à mon travail, quel est mon comportement si je n'ai pas de travail, ce qui se dit autour de la machine à café, comment j'occupe ma soirée, avec qui - conjoint, enfants, amis...
Ce petit livre démonte le moteur qui entraîne tous nos gestes machinaux, ceux qu'on fait sans y penser . Il lève le voile sur le squelette de notre vie de tous les jours.
Le temps (une de nos plus précieuses ressources)
Tout d'abord, la vie quotidienne, c'est du temps social, le 4è temps en quelque sorte après
- le temps cosmique (saisons, marées, cycles lunaires...°
- le temps biologique ( digestion, battement d'une paupière, pousses des ongles, règles)
- le temps psychique ( la façon dont nous appréhendons la durée).
Nous avons appris le temps social comme nous avons appris à compter et à lire. La société nous impose les mêmes unités de mesure sinon nous ne pourrions pas interagir ensemble.
Il y a le temps obligé ( le travail), le temps libre (loisir), le temps contraint (achats, démarches administratives, soins aux enfants...) et le temps de nécessité (sommeil, repas,...)
Les plus "fortunés" en temps ne sont pas forcément les mieux lotis sur le plan financier. Les plus aisés financièrement sont parfois pauvres en temps.
Mais le temps, c'est aussi de l'espace. Nos parcours dans cet espace peuvent être déterminés (maison-travail-courses), semi-déterminés (rendre visite à des parents, des amis, partir en vacance), ou libres (randonner sans but par exemple, partir au hasard). Le temps libre du prisonnier ou du malade dans son espace confiné sera dit aliénant.
L'auteur termine ce premier chapitre en traitant des rapports entre profane, sacré et la fête.
Moi et les autres.
Se socialiser, c'est puiser dans un stock de connaissances disponibles. L'individu est tributaire des autres pour cette information qui va lui permettre d'interpréter les situations de la vie quotidienne. C'est le sens commun.
Il cite Alfred Schütz:
« On m'apprend non seulement à définir mon environnement, mais aussi quelles constructions mentales typiques je dois concevoir en accord avec le système de significations légitimes qui sont acceptées du point de vue anonyme et unifié du groupe d'appartenance. »
« Il y a un noyau relativement petit de connaissance qui est clair, distinct et consistant par lui-même. Ce noyau est entouré de zones présentant des gradations variées de vague, d'obscurité, d'ambiguïté. Ensuite viennent les choses prises comme allant de soi, de croyances aveugles, de simples suppositions, de choses devinées, zones dans lesquelles on se contentera d'engager sa confiance. » (p.37)Mais pour que j'accepte de suivre les règles qu'on m'a appris, il faut que je leur trouve du sens. C'est la légitimation. Berger et Luckmann dégagent 4 niveaux de légitimation (p.51):
- Le langage (le père, avec ses attributs d'autorité, est celui dont il est dit qu'il est le père et cela suffit)
- Les propositions théoriques rudimentaires (proverbes, dictons, aphorisme, "mieux vaut être seul que mal accompagné")
- Les théories explicites (le droit , les règlements, les codes)
- Les univers symboliques : les religions, les visions du monde (le Parti, la Cause), la Science, la Littérature pour moi qui aime me définir comme un littéraire...
Ces 4 niveaux se combinent pour permettre à la société de maintenir un tissu social donné.
Le monde comme théâtre.
Je suis un piéton qui se rend d'un point à un autre, de ma naissance à ma mort. Si je rencontre quelqu'un, c'est un épisode, si il y a plusieurs épisodes, on dit qu'il y a une situation. Je dois croire que ces situations ont un sens pour les poursuivre. J'admets qu'elles sont réelles: «...les situations sociales n'ont pas d'autre réalité que celle qui leur est conférée, en raison d'une définition commune, par ceux et celles qui y prennent part. »
Définir et respecter une situation permet de conserver le lien social. Il y a parfois un décor et un script imposé, une réunion, une cérémonie. Il y a parfois un décor imposé et un scénario libre, un rendez-vous. On dégage ainsi quatre types élémentaires de situations.
Ensuite Claude Javeau s'appuie sur Erving Goffman pour nous montrer la vie de tous les jours assimilée à une scène de théâtre.
Il y a la scène où nous jouons un rôle et la coulisse où nous sommes naturels. Nous devons respecter une loyauté dramaturgique (ne pas trahir de secrets), une discipline dramaturgique (être capable de faire taire ses sentiments spontanés), une circonspection dramaturgique (prévoir, fixer d'avance). Ce sont les règles de surface d'une société donnée qui lui permettent de tenir.
Comme les rituels de présentation et d'évitement. On garde une certaine distance en se présentant, on attend un accusé de réception. Et quand on évite l'autre, on se met en scène, pour ne pas que sa "sphère idéale" soit violée, mais aussi pour ne pas violer la sienne. Il s'agit d'un "complot social" visant à colorer de confiance les relations sociales.
Ce chapitre se clôt sur le stigmate ( reconnaissance ou révélation d'un attribut qui entraîne le déclassement d'un individu, il peut être visible, invisible, moral, social....)
Le dernier chapitre s'appelle Aliénation et résistance.
Comment les individus montrent leur autonomie résiduelle: une capacité de résistance aux injonctions de l'ordre établi, un quant-à-soi qui permet de n'en penser pas moins.
Comment affirmer son irréductible singularité ? Il y a des tactiques: résistance au changement, affirmation des différences, prise au sérieux de l'insignifiance (ex: télé-réalité, sport de masse, vie privée des politiques)
D'ailleurs l'auteur conclut à propos de la duplicité de l'individu que la vie quotidienne, vue sous un certain angle, est un tissu de mensonge.
Nous sommes des piétons qui bricolons nos espaces de liberté dans les marges résiduelles que nous laisse le dispositif de domination qu'est la société. Certains ont plus de chance et de compétence que les autres, il peuvent explorer des possibles. D'ailleurs, cette capacité n'est pas réservée aux plus riches, " mais plutôt à ceux ou celles qui peuvent convertir le capital à dominante symbolique qu'ils ou elles détiennent en disponibilités temporelles. "
La sociologie de la vie quotidienne est d'abord une sociologie de la temporalité, à la fois des permanences et des changement perpétuels.On le voit, encore un petit bouquin plein de grandes idées, c'est très théorique. Mais on peut rattacher à chacune de ces idées des événements concrets de notre quotidien. Il permet de mettre des mots sur des choses ressenties et qu'on peut avoir du mal à formuler. Je vais essayer de faire un deuxième billet d'exemples. Encore une belle boîte à outils que j'ai terriblement résumé. Cette obsession de vouloir faire tenir un livre dans un billet de blog...
.JPG)