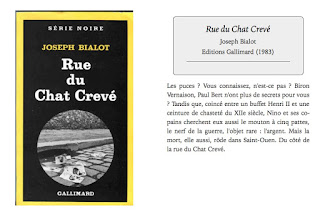Paul Klee Will Grohman (1968) Editions du Cercle d'art, traduit de l'allemand par Lucienne Netter.
C'est un beau livre, acheté d'occasion en bon état avec son odeur chaude, presque miellée, de vieux papier.
Will Grohman a connu Paul Klee et ce livre est un voyage initiatique dans le monde du peintre suisse, du mystère de la création : un peintre, jamais contesté, qui a créé des formes et des images nouvelles, jamais vues auparavant.
La première partie du livre, 50 pages, mêle la vie et l'œuvre.
Paul Klee a la fibre artiste, il aime la poésie, la musique et la peinture et il hésite entre ces deux dernières. Il choisira la peinture car c'est là qu'il y a le plus à faire, le plus à rattraper. La poésie, il la pratiquera en nommant ses tableaux. Et il continue à jouer du violon une heure par jour.
En 1911 il fait connaissance de Kandinsky, de Jawlensky, de Marc, de Macke et Rilke. Il admire le peintre Delaunay. Le voyage en Tunisie est pour lui une révélation : celle de la couleur.
En 1920, il publie un article qui aurait pu faire sensation et aurait du influencer l’art s’il avait été diffusé plus largement. En effet, Klee y fait participer le lecteur à la naissance et à la croissance de ses tableaux, au secret de leurs signes et de leurs symboles :
« L’art ne reproduit pas le visible mais le rend visible. Autrefois, on peignait des choses que l’on pouvait voir sur terre, que l’on aimait voir ou que l’on aurait aimé voir. Maintenant, la réalité des choses visibles est révélée, ce qui conduit à exprimer la croyance que par rapport à l’univers entier le visible n’est qu’un exemple isolé et qu’il y a d’autres vérités latentes en surnombre. Les choses apparaissent en prenant un sens élargi et diversifié et semblent s’opposer souvent à l’explication rationnelle d’hier. On s’efforce de dégager l’essence du fortuit. »
1921 est une année heureuse pour Klee où il produit 355 peintures, 212 aquarelles, 72 dessins. Le Bauhaus lui demande d’accepter une chaire de peinture.
 |
| ATELIER à WEIMAR, 1925 |
Dans son atelier du Bauhaus, il y a une douzaine de chevalets, il travaillait en effet à plusieurs tableaux à la fois. Il attendait souvent longtemps « jusqu’à ce qu’ils le regardent »; alors la plupart du temps la solution était trouvée et le tableau terminé.
Il côtoie Kandinsky, c’est une période faste pour le Bauhaus qui organise une fête légendaire. Klee augmente la production de ses oeuvres. Leur variété, le renouvellement et son invention attirent l’attention sur lui.
En 1924, il publie un livre d’esquisses pédagogiques où il expose ses concepts. Il compose ses tableaux faits de bandes, ses tabliaux réticulaires. Il expose l’éclaboussure en épargnant les parties recouvertes. Il laisse cette phrase à méditer: le profane pense à des ressemblances et l’artiste à des lois.
P.31 « Seul un homme ayant à sa disposition des intuitions et des images aussi diverses était capable de créer des oeuvres complètement nouvelles. » Will Grohman.
Mais à la fin des années 20, le Bauhaus se délite. Il obtient un poste à Dusseldorf, qu’il ne gardera pas longtemps car les nazis destituent les artistes qui produisent de l’art dégénéré . Klee a donc du temps libre, il en profite pour beaucoup voyager. Il s’offre un voyage en Egypte pour son cinquantième anniversaire.
Grohman décrit ses tableaux de l’époque avec les parallèles, les droites, les courbes, les alignements, les rebroussements. Pour Paul Klee, l’image formelle peut montrer des qualités rythmiques.
Klee n’a pas envie de quitter Dusseldorf où il y a une vie culturelle qu’il aime et des amis, mais il se fait de plus en plus souvent traiter de sale juif en pleine rue. Il revient donc dans sa ville natale, Berne, en 1933. Il vit modestement, malgré qu’il soit très célèbre.
Et arrivent les premiers symptômes de la sclérodermie, la maladie qui aura raison de lui.
Il n’y a qu’en 1936 que cela l’empêche de créer:on ne recense que 25 oeuvres. Les trois dernières années sont d’une richesse presque incompréhensible: 1937: 264 travaux, 1938: 489, 1939: 1253 et, l’année de sa mort, 366.
En 1937, il reçoit la visite de Braque et Picasso, qu’il vénère depuis sa jeunesse. Il meurt le 29 juin 1940.
La deuxième partie du livre parle des dessins de Klee. Il y en a environ 5000, qui étaient un matériel d’étude et d’archives. Klee ne les vendait qu’à contrecoeur.
« Au début il préférait le crayon; à partir de 1908, la plume et il s’y tint. En 1925 s’ajouta le pinceau qui joue un rôle encore plus important à partir de 1933; et en 1927 la plume de roseau. Vers 1930 il emploie à l’occasion le crayon ou le fusain, et à partir de 1932, le crayon zoulou, plus large; tout à fait à la fin le crayon domine à nouveau (Eidola). Quand il avait besoin d’un trait indirect et différencié, il se servait d’un calque qui’il fabriquait lui-même avec de la couleur à l’huile noire. La main posée dessus, sur une feuille blanche, produisait des taches énigmatiques tout à fait inopinées qui contribuaient à l’esquisse. »
La troisième partie concerne une cinquantaine de peintures qui sont décrites et analysées. Will Grohman aide le lecteur à comprendre un peu les énigmes posées par Klee, entre formes reconnaissables et abstractions. Il défriche pour nous et on tourne les pages d’un livre d’images, d’un livre d’énigmes, formes familières recréées, des images qui paraissent éternellement neuves.
On y voit notamment la Ville de rêve, avec ses ovales, triangle, carré, rectangle, fascinante, elle ouvre des paysages mentaux, l’imagination s’y engouffre.
 |
| Arbuste dans le buisson, 1919, huile sur papier |
 |
| Klee appelle cette oeuvre Ville de Rêve...Ces modulations du gris au vert et au noir en passant par le rose ont quelque chose d'irréel bien qu'on puisse reconnaître dans telle ou telle forme une plante, une tour ou une maison. Pourquoi un tel paysage n'existerait pas quelque part, peut-être même sur notre terre ? |
Will Grohman: une exaltante petite peinture à l'huile, un paysage avec des maisons et des arbres (les taches vertes), avec le dernier rayon de soleil (les accents jaunes) et plongé dans le rouge du soleil couchant. Le schéma de Kairouan le hante discrètement avec ses carrés et ses triangles, avec son organisation visible grâce à la structure plastique. L'année 1925 qui a vu naître ce tableau est l'année des premiers « carrés magiques » c'est ainsi que l'on pourrait désigner les compositions évoquant un échiquier et que l'on trouvera jusqu'à la fin de sa vie.
 |
| Ajouter une légende |
 |
| Le Prince noir, 1927, huile sur toile blanchie à la détrempe, collé sur bois. |
 |
| Lieu d'élection, 1927, papier de couleur, aquarelle et dessin à la plume. |
 |
Une chambrette à Venise, 1933, papier de couleur et pastel.
Un tableau onirique sur un papier bleu absorbant que les lumineuses craies de pastels laissent partout transparaître. Les couleurs sont le bleu, le vert-bleu, le mauve, mais où se mêlent d'autres tons intermédiaires ; c'est à peine si l'observateur se rend compte de leur nombre; il perçoit le rose fascinant, le bleu royal profond qui s’y intercale et il ne se demande ni Comment ni Pourquoi.
|
 |
| Dans la forêt profonde, 1939, détrempe et aquarelle sur toile. |
 |
| Eaux tumultueuses, 1934 |